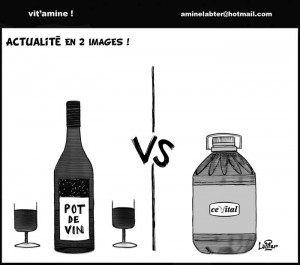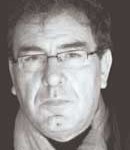
Comme souvent, pour ne pas dire toujours, je fais comme Balzac qui écrivait plusieurs livres en même temps. Incorrigible flemmard, je me contente, pour ma part, de les bouquiner. Je compulse simultanément trois, quatre parfois, cinq opus…
Tenez par exemple, un léger tableau synoptique et récapitulatif de ces derniers temps. Je finissais Les vies de Mohamed Arkoun (PUF), le portrait contrasté que consacre Sylvie Arkoun à son énigme de père, et qui n’a pas eu l’heur de plaire au grand critique littéraire Mohammed Aïssa, occasionnellement ministre des Wakfs. En même temps, je relisais, pour les besoins d’une recension parue dans ces mêmes colonnes (Le Soir d’Algérie du 30 juin), Si Zeghar, l’iconoclaste algérien (Ena Editions), de Seddik S. Larkeche et je plongeais dans les savoureux mémoires de Mohamed Saïd Mazouzi. Dans J’ai vécu le pire et le meilleur (Casbah), ce dernier raconte, avec l’aide de Lahcène Moussaoui, sur le ton humble qui est le sien, une vie de modestie, à la limite de l’effacement, et de combat consacré à un idéal, son pays.
Ces trois livres n’ont à vue de nez rien de commun. Ni du point de vue de l’écriture, ni de la démarche. Pas davantage en ce qui concerne les références auxquelles ils renvoient. Pourtant, ils convergent quelque part vers une même finalité. Ils racontent un parcours. Et je me suis dit qu’il y a tellement de zones d’obscurité dans notre histoire récente qu’il ne serait pas mauvais que quelques-uns parmi ceux qui savent se mettent à table… Qui ? Ah !…
Il va de soi que chacun de ces livres – et plein d’autres, qui sortent parfois en catimini — méritent d’être davantage connus et susceptibles d’une analyse détaillée.
Il se publie de plus en plus d’ouvrages, notamment de témoignages et de mémoires, et on ne devrait pas s’en plaindre. Au contraire, et c’est tant mieux même si cela complète sans le remplacer l’indispensable travail des historiens.
Souvent, ce sont des militants ou des hommes politiques, débloqués par l’âge canonique qu’ils atteignent et un nouveau climat propice à l’expression, qui ressentent le besoin de se mettre au clair avec leur passé et sans doute aussi celui de laisser une trace gravée dans un pan de postérité.
Il nous faut juste apprendre à lire ces témoignages et ces mémoires d’un œil critique, un mémorialiste ou un témoin ne produisant très souvent, et presque fatalement, qu’une parole subjective, partielle et modelée par son propre point de vue.
C’est encore à Mazouzi que j’emprunte cette prévention, dans les mémoires et autres témoignages qui fleurissent ces derniers temps, contre la possible tentation de verser dans une «histoire surfaite, magnifiée et confisquée par certains et à leur seul intérêt».
Mais il n’y a pas que ça… Il y a aussi des mémoires honnêtes…
Des publications ? Je pense pêle-mêle à William Sportisse et son Camp des oliviers (Presses universitaires de Rennes), Ahmed Mahi et son De l’Ugema à l’Unea (Inas), Sadek Hadjeres et Quand une nation s’éveille (Inas). Il faut ajouter les deux tomes d’Ahmed-Taleb Ibrahimi (Mémoires d’un Algérien (Casbah), les divers livres d’Ali Haroun et d’autres.
Tous ces livres et d’autres encore, innombrables, écrits seul ou en collaboration avec des tiers, racontent utilement un itinéraire dans cette démarche classique de continuer à servir sa cause en rappelant les rapports d’un individu avec un combat, et la mise en contexte politique d’une existence sociale.
La très brève bibliographie mémorialiste que je viens d’évoquer s’ajoute à des livres qui sont devenus des classiques du genre. Je pense dans le désordre là aussi aux politiques Ferhat Abbas, Hocine Aït Ahmed, Boudiaf, Chadli Bendjedid. Je pense aussi aux intellectuels comme Mohamed Harbi, Mostefa Lacheraf, Malek Benabi.
Mais aussi à des militants peut-être moins connus mais dont l’expérience et le parcours sont tout autant respectables, comme Hamou Amirouche, Djoudi Attoumi, Si El Hafid ou encore le sulfureux Mohand Arab Bessaoud.
Ou aux militaires : Tahar Zbiri, le général Hocine Benmaâlem, le prolifique et célébrissime Khaled Nezzar… Et voilà que je me lance exactement dans ce qu’il ne faut pas faire, l’énumération. C’est la voie la plus directe et la plus sûre d’aller dans le mur de l’oubli… Que les très nombreux témoins et mémorialistes que j’omets ici me pardonnent. Qu’ils se rassurent aussi, il est des historiens auxquels aucune ligne imprimée n’échappe…
En tout cas, beaucoup de militants du FLN, du PCA, des syndicats et organisations sectorielles, versent désormais dans l’escarcelle de la mémoire collective en déshérence leur écot de souvenirs.
J’avoue que personnellement, les témoignages et les mémoires forment un genre que j’apprécie particulièrement pour le côté romanesque.
Outre le fait de revenir fatalement sur des périodes de l’Algérie assez troubles, et quelle période ne l’est pas, je vous le demande, on découvre des hommes ou des femmes – très peu de femmes ont écrit : Louisette Ighil-Ahriz, Zoulikha Bekkadour – derrière les personnages qu’ils sont ou qu’ils se forgent.
Une déception, par exemple. Toujours intrigué par les événements d’Octobre 1988, je m’étais précipité sur les ouvrages de Khaled Nezzar puis de Chadli Bendjedid, espérant y trouver au moins partiellement la clé de l’énigme. Patatras ! Pas grand-chose à se mettre sous la dent.
Voilà pourquoi l’histoire racontée par ses propres acteurs est forcément relative.
Quand on a été, comme dans les deux cas précédents, aux responsabilités et qu’on a été contraints, ce faisant, à prendre des décisions de peu de noblesse, la tendance à l’autocritique et à l’évaluation neutre n’est pas nécessairement la denrée la plus courante lorsqu’on évoque ce passé.
Dans le pays du secret et du silence comme le nôtre, il y a toujours très peu de gens qui savent. C’est de ceux-là qu’on attend des révélations, non pas au sens de scoop livré au voyeurisme mais à celui d’informations qui permettent de comprendre des événements qui ont compté dans le destin national. Quand il y en a, elles ne sont pas toujours fiables et servent parfois moins à faire savoir à l’opinion publique ce qu’elle ne doit pas ignorer mais tout bonnement à régler des comptes et, de préférence, avec les morts. L’exemple, pitoyable, d’Ali Kafi s’en prenant à Abane Ramdane est là pour illustrer cette fâcheuse tendance.
Si on resserrait la focale sur les présidents de la République, censés être les hommes les mieux informés d’un pays, on s’aperçoit que sur ceux que l’armée a donnés à l’Algérie depuis l’indépendance, il n’y a, du point de vue de l’écriture, rien de déterminant. Ce que l’on sait de Ben Bella, qui aurait dû écrire davantage qu’il n’a parlé, raconté par lui-même, c’est surtout à travers les pléthoriques interviews qu’il a accordées les dix dernières années de sa vie.
Boumediène, qui était du genre à produire une réflexion à partir d’une pratique, est mort trop tôt et en plein exercice du pouvoir. Chadli Bendjedid a rédigé des mémoires qui semblent dûment expurgés. Lisses. Sans arêtes.
Boudiaf a été assassiné avant même que son action en tant que Président ait porté ses fruits. Son ouvrage «Où va l’Algérie», rédigé bien avant qu’il n’arrive au pouvoir, éclaire cependant une partie de son itinéraire.
Ali Kafi a eu, lui, le temps de déverser, en guise de mémoires, son fiel dans des écrits qui n’honorent pas le genre.
Liamine Zeroual reste silencieux. Lui aussi aurait sans doute beaucoup à dire à la fois sur les années 1980 et les démêlés avec Chadli Bendjedid et sur les années 1990. Trop peut-être !
Reste… Abdelaziz Bouteflika.
J’avoue que c’est à lui que j’ai pensé en relisant Zeghar, Mazouzi, Arkoun.
Pourquoi ? Parce que son itinéraire mériterait d’être raconté par lui-même. Depuis les années 1950, il est toujours là où se prennent les décisions. Là où s’exerce le pouvoir.
Il aurait sans doute bien des choses à verser lui aussi à la mémoire collective. Qu’il s’agisse de la prise de pouvoir par le clan d’Oujda, du coup d’Etat de juin 1965, de son rôle en tant que sempiternel ministre des Affaires étrangères de Boumediène, du décès de ce dernier et des luttes de sérail pour la succession. Il a été aux premières loges dans tous ces événements-clés et néanmoins peu connus.
Je crois que s’il n’avait fait qu’un seul mandat, pour le fun, et qui aurait été une façon raffinée de marquer l’histoire plus sensible à ceux qui s’en vont léger qu’à ceux qui s’incrustent lourdement, il aurait consacré le temps que lui auraient laissé tous les autres à ses mémoires. Cela aurait constitué un acte patriotique qui l’aurait adoubé avec panache par l’Histoire. Au lieu de quoi…
A. M.

![tvb[1]](http://oulmane.com/lesoir/wp-content/uploads/2015/10/tvb1.jpg)